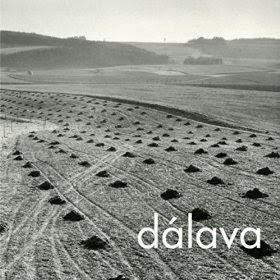La tradition veut que l'on puisse souhaiter ses vœux jusqu'à la fin janvier. Par extension, nous décrèterons qu'il en va de même pour l'établissement du traditionnel top 10 de l'année écoulée. En ce dernier jour de janvier, retour donc sur les dix disques les plus marquants de 2014.
Je notais dans mon
bilan 2012 la sur-représentation des artistes américains par rapport à ce qu'on trouvait chez certains de mes collègues blogueurs qui naviguent dans les mêmes eaux musicales que moi. Force est de constater qu'en deux ans, la tendance s'est complètement inversée chez moi. Mise à part la surprise de dernière minute - le nouveau D'Angelo après quatorze ans d'absence - les quelques autres Américains de ma sélection accompagnent des Tchèques et une Suissesse.
Si l'Europe est largement représentée cette année dans ma liste, ce n'est pas la seule caractéristique d'ensemble qu'on peut y déceler. La présence féminine y est également très forte, avec des filles qui chantent dans toutes les langues : en hongrois, en grec, en tchèque, à la trompette, au saxophone soprano ou au piano. Et, si le jazz semble toujours être l'axe autour duquel tourne mon univers, il connaît cette année une certaine extension, bien au-delà de ses limites habituelles.
Revue rapide des dix galettes en question. Comme tous les ans, le classement n'est qu'alphabétique.
Ce grand ensemble suédois, mené par le fougueux Martin Küchen au saxophone (découvert il y a quelques années au sein d'Exploding Customer), ne cesse de grandir. D'abord sextet sur ses deux premiers opus, puis octet sur le suivant, il ajoute encore une unité cette fois-ci. On y retrouve des noms fameux de la scène scandinave (Magnus Broo, Goran Kajfes, Mats Äleklint, Mattias Stahl, Johan Berthling, Andreas Werliin...) qui servent une musique expressive, lyrique et engagée, qui puise ses racines évidentes du côté du Liberation Music Orchestra de Charlie Haden.
Airelle Besson & Nelson Veras - Prélude (
Naïve)
Airelle Besson figurait déjà dans mon
bilan 2007, avec le premier album de Rockingchair. On la retrouve sept ans plus tard dans le contexte plus dépouillé du duo (avec le guitariste Nelson Veras). Mais, au-delà des différences apparentes, c'est le même profond sens mélodique de ses compositions et la clarté des lignes de sa trompette qui sautent aux oreilles. Le charme opère ainsi immédiatement, bien loin de l'austérité que pourrait laisser croire la formule instrumentale retenue.
Iva Bittova, Gyan Riley, Evan Ziporyn - Eviyan Live (
Victo)
Un trio à la croisée des chemins, entre folklores, improvisation et musique contemporaine, enregistré au fameux festival de Victoriaville (Québec). La violoniste tchèque y retrouve le clarinettiste de Bang on a Can, Evan Ziporyn, et accueille un guitariste d'auguste ascendance, Gyan Riley (oui, c'est le fils de). La musique est voyageuse, légère et joyeuse, parcourue de cris et de chuchotements, de vives stridences et de soyeuses mélodies, à l'image de ce que produit Iva Bittova depuis plus de 25 ans maintenant.
Sylvie Courvoisier Trio - Double Windsor (
Tzadik)
Une autre habituée de mes bilans annuels, dans un format des plus classiques (piano, contrebasse, batterie) mais pourtant inédit pour elle. La pianiste helvète est ici accompagnée par deux figures du New York downtown, Drew Gress (cb) et Kenny Wollesen (dms), et trouve un juste équilibre entre son style personnel - où semblent se mêler un goût des mécaniques bien huilées et une attention sans faille à la surprise du bruit - et la tradition du trio jazz qu'on ne l'avait encore jamais entendu toucher de si près.
D'Angelo & The Vanguard - Black Messiah (
RCA)
Toute la presse est unanime - et dithyrambique - pour saluer le retour de l'enfant prodigue de la
nu soul, quatorze ans après le déjà très salué
Voodoo. Je me joins sans problème au chœur des louanges, tellement ce disque, sorti sans préavis courant décembre, est une nouvelle preuve du talent de chanteur, de musicien, de catalyseur d'énergies (Questlove, Q-Tip, Roy Hargrove, Pino Palladino, Chris Dave...) et d'arrangeur du soulman américain. Dans un écrin aux codes familiers, il distille ainsi mille nuances et subtiles surprises qui renouvellent et accentuent le plaisir à chaque écoute.
Alexandra Grimal & Giovanni di Domenico - Chergui (
Ayler Records)
Parmi les noms qui apparaissent régulièrement sur ce blog (enfin, quand il ne dort pas honteusement pendant plusieurs mois), il y a celui d'Alexandra Grimal. Alors qu'elle participe depuis le début de l'année à la nouvelle mouture de l'ONJ sous la direction d'Olivier Benoît, la saxophoniste poursuit en parallèle l'exploration de formats plus intimes. Le pianiste italien Giovanni di Domenico est un complice de longue date d'Alexandra (déjà un disque en quartet et un précédent duo), et cela s'entend sur ces deux CDs qui laissent une grande part au silence et à la retenue, comme pour mieux faire briller les joyaux soniques des deux musiciens. Avec notamment deux longs solos de toute beauté au soprano de la part d'Alexandra (
Prana,
Diotime et les lions) qui justifient à eux seuls l'acquisition de cet album.
Une autre production de l'excellent label Ayler Records aux couleurs franco-italiennes s'est glissée dans ce bilan 2014. Avec son jazz chambriste tour à tour débridé et mélancolique, le pianiste Roberto Negro met en valeur son sens de l'architecture et de la dynamique pour donner un caractère quasi narratif à sa musique. Les cordes des frères Ceccaldi (Théo au violon et Valentin au violoncelle) vrombissent et dérapent ici, soulignent et infléchissent le discours là, et dévoilent les contours d'une nouvelle manière d'agencer les musiques improvisées et composées. L'ensemble entre en résonance avec de multiples références, tout en réussissant à trouver le chemin de la singularité.

Un album de chansons, en grec et en italien, en espagnol et en français, servies par la voix chaude et d'une grande justesse d'Elsa Birgé. Les folklores d'Europe mis à l'honneur sont magnifiés par l'écrin des cordes de Lucien Alfonso (vl), Karsten Hochapfel (vcl, g) et Pierre-Yves Le Jeune (cb), habitués du champ des musiques improvisées, qui réussissent ainsi à insuffler une forte dose de fraîcheur et de surprise dans ce répertoire traditionnel. La petite fille de 9 ans qui chantait
Vivan las utopias ! sur le disque hommage à Buenaventura Durruti publié par les éditions Nato en 1996 a su faire fructifier de la plus belle des manières son goût du chant, et nous le faire partager avec bonheur en 2014.
Encore des chansons, encore des musiciens qui naviguent dans les eaux troubles des musiques indéfinissables. Cette fois-ci, la langue est tchèque - celle de Julia Ulehla - et les cordes sont new-yorkaises tendance downtown. On retrouve ainsi quelques habitués des productions zorniennes, à commencer par Aram Bajakian à la guitare et Shanir Blumenkranz à la contrebasse. Deux violonistes - Tom Swafford et Skye Steele - complètent le line-up. Folklore morave ré-imaginé sur la base des travaux ethno-musicologiques de l'arrière-grand-père de la chanteuse, l'ancestral y côtoie sans heurt le contemporain.
Zsuzsanna Varkonyi - Banat / Vagabond Songs (
Gabbiano)
Mon goût pour les traditions d'Europe centrale se confirme avec ce nouvel album de la chanteuse magyaro-parisienne. La langue est ici majoritairement hongroise, mais aussi anglaise, française ou romani. Là aussi violon (Frédéric Norel) et guitare (Csaba Palotaï) ont déjà été aperçus dans un contexte plus ouvertement jazz (tout comme Sylvain Lemêtre aux percussions). L'ensemble est très addictif, délicat dans ses arrangements, puissant dans son expressivité.